Notice
Mon attachement à Monteverdi remonte à plus d’un demi-siècle. Une soirée des Jeunesses Musicales de France était consacrée vers 1950 au bel canto, et Monteverdi en était présenté comme l’inventeur. Indifférent à la plupart des exploits du XIXème siècle, j’avais été bouleversé par celui qu’on ne me présentait alors que comme un précurseur. Lorsqu’en février 1976 Radio-France inaugura sa série des Perspectives du XXème siècle, ce fut – déjà-, avec une journée Mâche-Monteverdi. Ce que je trouve chez ce grand ancêtre, c’est une parfaite harmonie entre le moderne et l’intemporel. La seconda prattica n’est pas, comme chez certains de ses contemporains, une recherche d’innovations maniéristes, mais, suscitée sans doute par l’utopie d’une Antiquité retrouvée, l’expression la plus libre d’une nature humaine de tous les temps. Les meilleurs moments de Monteverdi n’ont pas d’âge, et de ce fait nous parlent la langue d’aujourd’hui. Il faut bien reconnaître, par exemple, que le récit de la messagère de l’Orfeo est beaucoup moins désuet que tel grand air de Rigoletto.
Commentaire
Ce n’est que récemment que l’ambiguïté de mes rapports avec les musiques du passé m’est apparue dans ce qui me semble être sa vraie dimension. Mon aversion de toujours pour les néo-classicismes et ma recherche de l’intemporalité mythique ont toujours co-existé avec un profond désir d’innovation, et chez moi le refus de l’histoire comme dimension unique de la création musicale ne s’est jamais identifié au refus de la modernité comme principal moteur de la création. Par-delà mon cas personnel, je crois que cette tension entre deux aspirations antagonistes est celle même que vit notre société. Si le besoin d’intemporalité devait, comme dans les sociétés traditionnelles si bien interprétées par Mircea Eliade, se traduire par le refus du temps historique, alors la nostalgie de ce qui est permanent et accordé à la durée de la vie humaine conduirait à l’abandon du modèle de dynamique européenne qui a conquis aujourd’hui le monde, y compris certaines sociétés arc-boutées sur d’autres valeurs. Et si cette dynamique devait perpétuer sa fuite en avant, elle ne pourrait que s’étouffer elle-même dans ses contradictions et sa déshumanisation. La crise esthétique de la modernité militante qui a éclaté après mai 68 ne faisait qu’annoncer celle de la société industrielle, condamnée à une perpétuelle innovation que la planète ne peut déjà plus supporter. On soupçonne maintenant que seule l’invention d’une économie fondée sur la décroissance promettrait quelque avenir à l’humanité. On devine que parmi les valeurs piétinées par l’avènement de l’industrie, certaines correspondaient à des données plutôt intemporelles que périmées. Le besoin mythique est irrépressible, et tout le problème est de l’intégrer à une histoire non moins inéluctable.
La terza prattica n’est qu’un divertissement sans commune mesure avec ces perspectives, mais elles n’ont pas cessé de leur servir d’horizon lointain. Aucun retour à Monteverdi n’est au programme, pas plus qu’à Bach ou à quiconque, mais rendre simultanément présents et compatibles l’intemporel et l’innovation est un objectif intéressant, ou peut-être une utopie un peu folle.
Instrumentation
clavecinCréation
25 janvier 2004, La Filature, Mulhouse, E.Chojnacka
Éditeur
Commanditaire
Dédicataire
Disques
Textes
Critique – La terza prattica
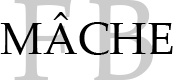
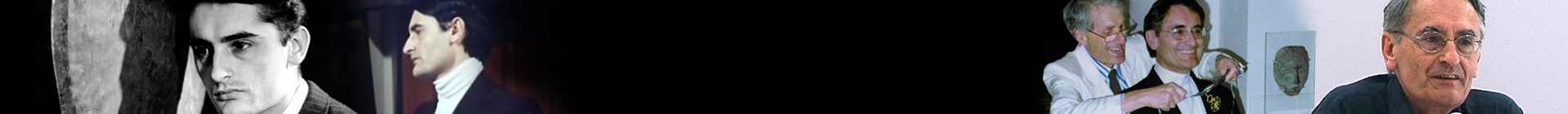
 Aperçu partition
Aperçu partition